Et peut être en introduction… : qu’est-ce qu’un jubé ?
Un jubé est une structure architecturale que l’on trouvait autrefois dans certaines églises, principalement à l’époque médiévale et à la Renaissance et qui sépare le nef du Choeur. Un des plus connus est dans doute celui de la cathédrale d’Albi ; ci-dessous :

La disparition du jubé de l’église d’Aumale est mentionnée dans plusieurs ouvrages et en particulier dans l’histoire d’Aumale par Ernest Sémichon.
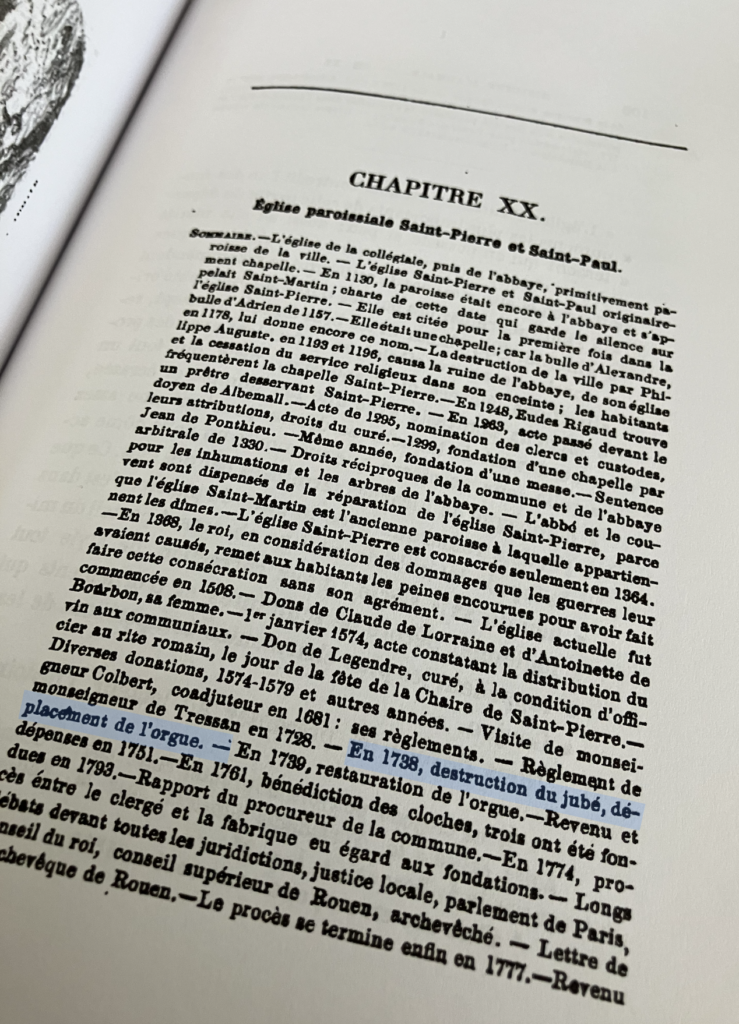
La disparition du jubé d’Aumale : une réforme liturgique en action
Le jubé de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul d’Aumale, disparu en 1738, s’inscrit dans un mouvement général de transformation des lieux de culte catholiques après le concile de Trente (1545-1563). Cette cloître architecturale, typique des églises médiévales, séparait originellement le chœur réservé au clergé de la nef occupée par les fidèles. Son démantèlement répond à une volonté de l’Église de rompre avec une pratique perçue comme obsolète et de recentrer la liturgie sur la participation active des laïcs.
Un obstacle à la nouvelle spiritualité tridentine
Le concile de Trente, en réaction à la Réforme protestante, cherche à renforcer la dimension collective de la messe. Les jubés, jugés trop enclavants, deviennent symboles d’une séparation contraire à l’idéal d’unité prôné par Rome. À Aumale comme ailleurs, leur suppression vise à offrir une vue dégagée sur le maître-autel, permettant aux fidèles de suivre les rites eucharistiques sans intermédiaire visuel.
1738 : une date tardive pour une tendance générale
Si certaines régions voient disparaître leurs jubés dès le XVIᵉ siècle, celui d’Aumale résiste jusqu’au début du XVIIIᵉsiècle. Cette longévité s’explique probablement par des facteurs locaux – attachement local, coût des travaux – avant que les injonctions épiscopales ne finissent par s’imposer. La décision de 1738 s’accompagne alors souvent du déplacement des autels latéraux vers les chapelles, libérant la nef pour les processions.
Conséquences architecturales
La disparition du jubé modifie radicalement la perception spatiale de l’édifice. Le chœur gothique flamboyant, désormais visible depuis l’entrée, acquiert une dimension théâtrale. Cette ouverture préfigure les aménagements du XIXᵉ siècle, comme la restitution de la nef par l’architecte Lefort (1890-1893), qui parachèvera cette quête de monumentalité.
Un témoin silencieux des mutations religieuses
Aucun vestige matériel du jubé d’Aumale ne subsiste aujourd’hui, contrairement à d’autres églises où des fragments sculptés ont été réemployés. Sa disparition matérialise le passage d’une liturgie cloîtrée à une spiritualité d’adhésion collective, reflet des bouleversements théologiques de l’époque moderne.
Cette transformation, loin d’être anecdotique, illustre comment l’architecture sacrée épouse les évolutions doctrinales.



N’oubliez pas soutenir la mission d’AUMEA et de contribuer, vous aussi, à la restauration de la l’église d’Aumale. L’ensemble des dons enregistrés en 2025 seront versés intégralement à la mairie d’Aumale et donneront lieu à une déduction fiscale.

No responses yet